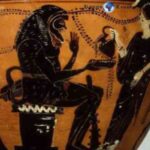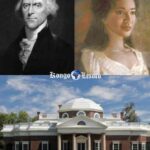Phillis Wheatley (1753 – 5 décembre 1784) fut la première poètesse Noire/Africaine notable et la première femme Afro-Américaine à voir ses œuvres publiées. Née en Afrique de l’Ouest, au Sénégal, elle a été kidnappée lors de raids par des marchands d’esclaves Blancs/Occidentaux armés et vendue comme esclave à l’âge de sept ans en Amérique du Nord.Elle a été acheté par un certain John Wheatley et sa femme Susannah.
Mary, la belle-sœur de M. Wheatley, voyant l’enthousiasme de Phillis, lui apprit à lire et à écrire, et encouragea sa poésie en lui prêtant des livres d’histoire, de géographie, d’astronomie et les œuvres d’anciens poètes tels (qu’Horace, Virgile, Ovide, Homer, Phillis entre deux tâches domestiques), s’imprègne de ce savoir et dépasse rapidement en culture les enfants des planteurs.
Dès l’âge de 13 ans elle compose de beaux poèmes, flatte ses maîtres et l’exhibe en société. Évidemment ces poèmes ne sont pas encore d’une grande originalité, mais qu’ils existent relève déjà du miracle. Peut-on imaginer Victor Hugo, le soi-disant génie national français, pris dans une rafle à l’âge de sept ans puis, après avoir été asservi dans un pays lointain, composer à cet âge des poèmes dans une autre langue qu’il ne maîtrise même pas ? Mais comme personne ne pouvait imaginer qu’une femme Noire/Africaine soit assez intelligente pour écrire de la poésie, elle fut convoquée pour défendre son talent lors d’un procès qui eut lieu en 1772.
Imaginez la droite dans son fauteuil, face à 18 examinateurs de perruques. On lui demande des renseignements sur les dieux grecs et sur les personnages de la Bible. Elle est soumise au supplice de la dictée et des conjugaisons grecques et latines. On lui demanda de traduire des textes de Virgile, de réciter dans sa tête des passages du Paradis perdu, et même ses poèmes. « La jeune Phillis tient tête à ses juges. Ainsi, après avoir recueilli le témoignage de son professeur, du gouverneur, du lieutenant-gouverneur et de 15 autres notables, le groupe d’érudits de Boston chargé de l’examiner a finalement conclu qu’elle avait bien écrit les poèmes qui lui disaient qu’on lui attribuait et a certifié que (le petite esclave nègre) est bien l’auteur de ses textes ».
Ils ont signé un certificat qui figurait dans la préface de son livre, Poèmes sur divers sujets, religieux et moraux, publié en 1773 à Londres, où il avait été publié faute d’acceptation à Boston. Phillis et son fils aîné Nathanial Wheatley se sont ensuite rendus à Londres, où Selina, comtesse de Huntingdon et comte de Dartmouth ont aidé à sa publication. Certains critiques considèrent la défense réussie de Wheatley devant le tribunal et la publication de son livre comme la première reconnaissance de la littérature Noire/Américaine.
Voici quelques événements importants dans la vie de Phillis Wheatley :
- En 1753, Phillis Wheatley est né en Gambie ou au Sénégal;
- En 1761, capturé en Afrique et transporté en Amérique sur le navire négrier Phillis. Phillis est arrivée en Amérique le 11 juillet 1761. Elle a été vendue à John Wheatley, Massachusetts pour travailler comme femme de ménage pour son épouse Susanna Wheatley. Phillis a été baptisée et nommée d’après le navire qui l’a amenée en Amérique (Phillis) ;
- En 1762, Phillis montra son intelligence et sa curiosité pour les livres. Elle a appris à lire et à écrire avec l’aide de Susanna et Mary Wheatley;
- En 1767, Phillis Wheatley écrivit (Une adresse aux athées et une adresse aux déistes). A publié son premier poème (On Mr Hussey and Coffin) dans le Newport Mercury;
- En 1768, Wheatley écrivit (Très Excellente Majesté le Roi) louant le roi George III pour l’abrogation du Stamp Act;
- En 1769, Wheatley écrivit son poème (Atheism) qui ressemble à (An Address to the Atheist), écrit deux ans plus tôt;
- En 1770, elle se fait connaître pour sa poésie après avoir écrit un hommage à George Whitefield (un poème élégiaque sur la mort de ce célèbre divin et éminent serviteur de Jésus-Christ, le révérend M. George Whitefield). Il était un évangéliste populaire et servit comme aumônier de Selina Hastings, comtesse de Huntingdon, qui allait devenir la patronne de Phillis;
- En 1772, Phillis Wheatley a défendu sa paternité devant le tribunal devant 18 hommes à Boston, dont (John Hancock, John Ervin, Thomas Hutchinson et Andrew Oliver), qui ont ensuite rédigé une attestation selon laquelle Phillis Wheatley était bien l’auteur de son propre travail;
- En 1773, Phillis Wheatley se rend à Londres où est publié son premier livre (Poèmes sur divers sujets, religieux et moraux). Le livre contient trente-neuf poèmes. Le recto de la première édition montre une gravure de Wheatley par Scipio Moorhead, l’esclave de John Moorhead. Le livre a été financé par Selina Hastings. La maladie de Susanna Wheatley a nécessité le retour de Phillis de Londres. Lorsque Mme Wheatley mourut en 1774, Phillis fut libérée, mais continua à vivre avec les Wheatley jusqu’à la mort de M. Wheatley en 1778, lorsqu’elle dut quitter la maison;
- En 1775, Phillis Wheatley écrit un poème (À Son Excellence George Washington), elle loue son héroïsme et soutient la Guerre d’Indépendance;
- En 1776, George Washington invite Phillis chez lui pour une lecture privée pour la remercier du poème;
- En 1778, Phillis épousa John Peters, un homme noir/africain libre, avec qui elle eut trois enfants;
- En 1784, Wheatley écrivit (Une éloge funèbre, sacrée à la mémoire du grand divin, le révérend et savant Dr Samuel Cooper). Cooper était pasteur de l’église de Brattle Square et était un partisan actif de la révolution. Wheatley a écrit ce poème peu de temps avant sa mort. John Peters a été emprisonné pour dettes impayées. Phillis a trouvé du travail dans une pension. Le 5 décembre, Phillis Wheatley est décédé à l’âge de 31 ans.
Poème : Tout jeune encore, par un destin cruel, j’ai été arraché à l’Afrique, berceau heureux. Quels tourments, quelles douleurs n’auraient pas dû déchirer le cœur de mes parents ? Quelle âme de fer avait celui qui a enlevé à son père son bébé bien-aimé ?? Tel était mon malheur. Alors je ne peux que prier. Puissent les autres ne jamais ressentir cette tyrannie. Phillis Wheatley, Poésies sur divers sujets, religieux et moraux. (Source : Lilian Thuram, mes Étoiles Noires, pages 109-115).